LE SANGLOT DES FEMMES NOIRES EN FRANCE
EXCLUSIF SENEPLUS - Dans l’afroféminisme, l’identité a supplanté le genre - En Afrique, l'afroféminisme n’a aucun écho, il faut noter que les travaux des pionnières des années 60 sont très éloignés de la conception actuelle
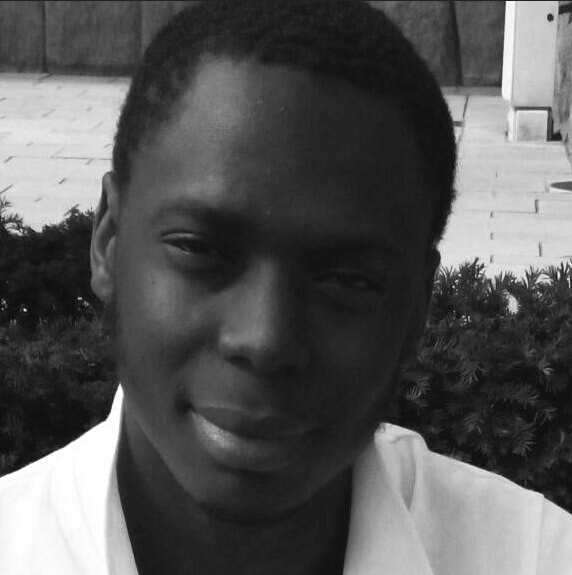
La séquence médiatique articulée autour de l’organisation d’un festival non-mixte Nyansapo (28-30 juillet 2017) a coché toutes les cases de la force régnante du « polemos » culturel en France. Force mettant en scène les deux lames de la cisaille identitaire. Arène de choix comme presque toujours, les réseaux sociaux, où la loi de l’hygiénisme moral s’autoalimente en querelles, et nourrit le cordon politique.
Symbole d’un vrai marqueur en France, et d’un malaise profond que les élections présidentielles ont contourné, les affaires de mœurs sur l’islam, la vêture des femmes, l’antiracisme, le schisme féministe, etc., s’abreuvant de fait tous dans l’inachevé du surmoi colonial, ont vocation à encore empester le débat. Du burkini, au troquet de Sevran, en passant par les reportages de M6, et ce qu’ils sont le produit de contre-enquêtes, il y a deux France irréconciliées, peut-être irréconciliables, que ni la prophétie heureuse du multiculturalisme, ni le républicanisme rigide, ne peuvent fédérer.
La distance et le temps découvriront bientôt la fragilité de l’entre-deux Macroniste. C’est le fruit de postures à gauche mijotées dans le tremplin de la contestation en Algérie et ce qu’elle a produit de maternalisme, avant Terra Nova, envers les minorités. C’est aussi le fruit d’un paternalisme, type rive droite, affairiste, dont les relents coloniaux dans la Françafrique notamment, ont créé le plus grand stock de rancœur contre la France de la part du spectre indigène. Cette fracture originelle, entre vaincus de l’insécurité culturelle, et oubliés de l’insécurité historique, opposant en réalité, petits blancs et petits noirs, a été à tort analysée dans le seul registre du bien et du mal, entre « racistes » et « racisés ».
Cette malheureuse simplification sert de festin national pour nourrir la bonne conscience des uns, et les fantasmes des autres. Or l’enjeu, beaucoup plus complexe, se trouvait dans la fabrication d’un récit commun qui ne sacrifie rien aux valeurs profondément humanistes, universelles, inclusives et ne font pas place au relativisme. La démission dans cette entreprise, tâche ardue, explique les fuites en avant entre les radicalisations à l’œuvre, l’afroféminisme n’étant qu’un pôle de cette dynamique de sécession.
Le postulat des afroféministes
Dans la foulée du camp d’été décolonial, en 2016, qui cliva jusqu’à la rédaction de Médiapart – c’est dire – autour de la pertinence de la non-mixité, le festival Nyansapo s’inscrit dans la même perspective : celle d’un féminisme offensif, provocateur, réinventant des recettes anciennes souvent importées des USA, en aplatissant tous les contextes, pluralités, sur l’autel du seul combat radical qu’elles mènent. Pour ce faire, un détour par leur diagnostic fondateur est nécessaire, en voici le postulat : l’Etat français est raciste et islamophobe, du fait de son ascendance coloniale, des discriminations à l’embauche, et à travers son bras répressif policier, dont les crimes (ou bavures) et les contrôles au faciès en sont d’irréfutables preuves.
Dans la charge contre l’Etat, sont aussi désignées et délégitimées, les associations antiracistes classiques, requalifiées de gadgets sans âmes, reproduisant inconsciemment la domination « blanche » par l’absence, ou la faible présence des minorités dans leurs directions. Jugées aussi plus enclines à se mouvoir contre l’antisémitisme, ces associations subissent les foudres du nouvel antiracisme qui se dit politique. Les démêlés judiciaires de Dieudonné ont été autant de temps forts, exprimant le fameux « deux poids deux mesures », source à laquelle s’abreuve le contre-récit. Cela entériné dans leur manifeste, l’actualité et les affaires, ne viennent que réaliser l’oraison annoncée. La preuve est ici moins importante que la prédiction ; l’apriori annonçant toujours le postériori.
Aux deux postulats qui soulignent déjà la sévérité du diagnostic et la radicalité de la démarche, s’ajoute le lexique relevant presque du jargon : intersectionnalité, blanchité, la division du monde en camps blanc/non blanc, pour déconstruire désigné « le privilège blanc ». Et pour ce faire, seul axe : la revendication d’un différentialisme ethnique ou religieux, le seul, estiment-elles à mesure de comprendre la souffrance ressentie et capable de mener une lutte sans concession.
La non-mixité, ancienne stratégie, nouvel instrument
Dès lors les stratégies de lutte comme la non-mixité sont plus des symptômes qu’autre chose. Ce qu’elle charrie de plus profond est beaucoup plus inquiétant que le manque de mélange, que les séparations géographiques ont déjà partiellement dessiné. Le refus de la mixité, dans une acception plus large, pensée comme le lieu d’élaboration sans filtre d’un discours, sans les pudeurs et les entraves qu’elles engendrent, aurait éventuellement pu être compris. Mais ce que cette non-mixité du festival Nyansapo condamne, c’est d’abord la pluralité, la diversité du débat au sein même des populations dont elles se proclament les hérauts.
Voici, ramassés, les arguments du sectarisme admis, puisant ses forces dans le privilège inversé du statut de victime. Ainsi libellées, les marges de dialogue étaient déjà inexistantes, une telle radicalité étant irrecevable, mais grâce à l’écho dans une certaine gauche universitaire et médiatique et son primat de l’empathie envers les victimes de l’histoire, cet antiracisme forcené a trouvé un terrain de légitimation, un droit de cité, et l’inespérée caution sans laquelle il serait resté marginal. Car, malgré le renfort de publicités, ce genre de rencontre draine assez peu de monde, et n’est pas représentatif des différents courants féministes au sein même de la communauté des « noires ».
Ces rencontres sont le fait d’agitatrices habiles, surinvestissant les réseaux sociaux pour corriger leur déficit de popularité. Elles s’adressent aux canaux de légitimation dont, pour une fois, elles minorent le caractère blanc honni, pour se suffire d’affinités idéologiques. En captant cette énergie, cette gauche leur donne de l’ampleur, mais en cédant à l’essentialisation d’une poignée de personnes qu’elles désignent comme fer de lance, elles retombent dans un travers qu’elles ont historiquement combattu : l’aplatissement de toutes les différences et l’intervention aliénante dans le calendrier des anciens colonisés.
Le droit des femmes ou l’ennemi blanc ?
Il est frappant du reste, de noter que pendant ces séquences, l’on parle assez peu de féminisme au final. Dans l’afroféminisme, l’identité a en effet supplanté le genre ; le blanc cristallise la seule domination urgente à combattre. En cédant la place aux seuls enjeux identitaires, la question du genre, et de la libération des femmes, est réduite à cette seule surface de protestation contre le postulat blanc. Ça exonère ainsi des luttes contre les patriarcats divers d’obédience culturelle ou religieuse, notamment ceux des cultures d’origines, où le statut de la femme, pour user d’un euphémisme, peine à émerger. En Afrique, par exemple, cet afroféminisme n’a aucun écho, il faut noter que les travaux des pionnières des années 60 sont très éloignés de la conception actuelle. L’afroféminisme paraît ainsi plus que jamais dans une usurpation de préfixe comme de suffixe, la condition des femmes africaines et de leurs collègues de la diaspora soumises au fait traditionnel, devenant secondaire.
Cette bascule qui fait du « nous » indigène un tabou inquestionnable, vers le « eux », héritiers du schéma de domination colonial, est l’argument de l’absolution interne, même pour les viols commis par des racisés. Théorisée ainsi, notamment sous la plume incendiaire de Bouteldja, cette clémence voire cécité des logiques de dominations intra-communautaires, doit centrer la cible sur le seul ordre blanc, dont le mâle de 50 ans est devenu l’odieuse mascotte. Un tel positionnement questionne. Il acte l’emprise d’un « ennemi » dont il épouse l’agenda et conséquence annexe, il ne se définit que par rapport à lui, avouant ainsi implicitement l’incapacité d’une souveraineté. L’inconfort que cette position produit, même masqué par la surabondance de radicalité, met en lumière un sectarisme, où l’antiracisme, excluant toutes les autres composantes, devient lui-même différentialiste, et sinon raciste, à tout le moins racialiste.
L’ethnie seule constitue l’identité, sans possibilité d’intégration de facteurs comme les actes, les produits, les évolutions qui définissent les individus. Ce fixisme produit d’ailleurs cette inexpugnable chasse contre les membres de la communauté qui ont le tort de penser autrement. Ils sont vite requalifiés, par l’insulte ultime, de « nègres de maison ». Audrey Pulvar en a été une des principales victimes. L’idée en suspens, dangereuse, qu’émet ce genre de position, est celle d’une uniformisation qui au nom de la différence, exclut de manière interne toutes celles qui écornent ce récit de la radicalité. Elle reprend à rebours l’idée longtemps raciste, d’ailleurs fondatrice du différentialisme colonial : que tous les noirs sont identiques. Idée maquillée des faux atours de l’unité.
L’émancipation a toujours eu la tentation de la vengeance. Le collectif Mwasi tangue de ce côté. En reprenant tous les codes de l’exclusion au nom de l’essence d’un combat, en se refermant dans une seule optique, elle contribue à ériger des cloisons qui ont vocation à faire de la différence une barrière et non le fondement de l’altérité. Il faut être sensible au cri des « afroféministes» qui, du sanglot, a le désespoir, de la rage, l'impuissance, de la colère, la maladresse, de la militance, le slogan. Il faut l’appréhender comme un autre signe du malaise du temps. Le séparatisme d’une partie importante de la population qui ne se reconnaît pas dans le miroir national français. Voici le chantier immense du « faire peuple » qui doit disqualifier tous les extrémistes.













