DE LANGUE À LANGUE : NOTE DE LECTURE SUR UNE ONTOLOGIE DE LA TRADUCTION
Publié en 2022 aux éditions Albin Michel, le texte de Souleymane Bachir Diagne aurait bien pu être dirigé contre cet ésotérisme des expériences subjectivées. Mais l’essai est opposé à une chose autre, clairement nommée : "une ethnologie de la différence"
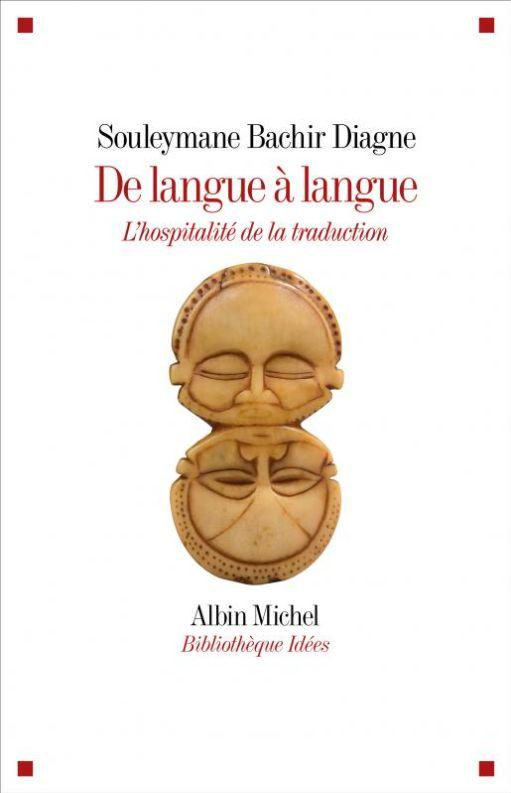
Écrire sur la traduction est un exercice délicat dans un contexte où les solipsismes individuels et collectifs gagnent en épaisseur et en consistance. En proclamant l’inaccessibilité d’expériences dont les authentiques clés d’interprétation resteraient entre les seules mains des individus et groupes les ayant vécues, les discours solipsistes contemporains font passer les expériences particulières du monde au statut d’intraduisibles. Publié en 2022 aux éditions Albin Michel, le texte de Souleymane Bachir Diagne aurait bien pu être dirigé contre cet ésotérisme des expériences subjectivées. Mais l’essai est opposé à une chose autre, clairement nommée : « une ethnologie de la différence ».
A celle-ci Bachir oppose en effet un « principe de charité » qui est au cœur du travail de traduction. A l’égard des langues, cette charité procède par « mise en rapport ». La traduction apparait ainsi, sous la plume de Bachir, davantage comme un processus relationnel que comme un troisième terme qui viendrait s’ingérer dans les rapports entre deux langues. Le sous-titre de la conclusion (« la langue des langues ») peut donc tromper : la traduction gagne certes sa propre positivité, mais comme relation. Elle est « mise en rapport », créatrice de réciprocité entre langues, mais peut également « manifester » des rapports d’inégalité à l’instar de ceux caractérisant l’espace colonial.
A travers cinq chapitres qui se lisent de façon très fluide, Bachir dénoue magistralement les décisions savantes qui voudraient ériger des barbelés de l’intraduisibilité entre les langues, les cultures. C’est alors tout naturellement « contre l’effet de l’instinct de tribu » que le commentateur de Bergson fait apparaître la nécessité de la traduction comme « rencontre dans une humanité partagée ». La dimension téléologique d’un tel choix paraît assumée, tant l’humanisme qui le fonde transparait de façon explicite au fil des pages.
Logique et langues
C’est le philosophe américain Willard O. Quine que Bachir mobilise dans cette entreprise dès le premier chapitre, pour fragiliser les bases de « l’ethnologie de la différence » et ouvrir la discussion sur le « statut anthropologique de la logique ». Double fragilisation, au moins pour un moment ! Car ni le particulariste de creuset ni l’universaliste de surplomb ne se trouvent rassurés. Ce sera au moment de traiter d’une philosophie de la grammaire qui serait propre à chaque langue que Bachir va se montrer lui-même plus décisif sur le statut de la logique.
A la faveur d’une réflexion sur une querelle emblématique ayant marqué l’histoire de la philosophie islamique, l’auteur revient sur l’opposition entre l’idée d’une logique qui serait propre à chaque langue et l’idée d’une logique inhérente au raisonnement humain de façon générale. Un détour fort utile est l’exemple que constitue l’arabe de ne pas être une langue « à copule » au même titre que le grec.
Quand on attribue, en langue grecque, un prédicat à un sujet, le rôle que joue la copule « est » en grec dans l’exemple « Socrate est philosophe » se voit en quelque sorte rempli en arabe par le pronom personnel « lui », de telle sorte que cette proposition devienne en arabe : « Socrate, lui, philosophe ». C’était en tout cas la traduction préférée par des philosophes arabes comme Matta qui, en procédant de la sorte, transformèrent en une « relation logique entre deux termes » ce qui se présentait en grec sous la forme d’un prédicat intrinsèque (philosophe) à un sujet (Socrate) : « Ainsi (…) la relation qu’établit le pronom personnel indique-t-elle que l’individu "Socrate" appartient à la classe de ceux qui possèdent la propriété "philosophe" ».[i]
Il nous est pourtant permis de douter de la portée ontologique d’une telle transformation. La classification, qui est un mécanisme cognitif pour regrouper et distribuer des choses discrètes dans divers ensembles, est nécessairement fondée sur la similitude des prédicats imputés à celles-ci. En arabe comme en grec, l’opération que décrit Bachir aboutit nécessairement à une classification dès lors que l’on songe à regrouper diverses entités dénommées « philosophe » dans un même ensemble ; la transformation de l’inhérence du prédicat en relation ne menant guère à un assemblage relationnel en tant que tel. Alors que l’opération classificatoire prend appui sur la similitude des attributs intrinsèques, un assemblage relationnel se fonderait plutôt sur la compatibilité des positions, à l’instar des termes de parenté qui en fournissent un bon exemple d’objectivation sociologique.
Et ici, nous nous trouvons bien en face d’une opération classificatoire, car ce qui permet de parler d’une classe des philosophes, ce sont bien les traits intrinsèques similaires que ces derniers sont réputés partager et auxquels sont assujetties les relations entre philosophes. Autrement dit, au sein de la classe, la prévalence des termes sur les relations reste inchangée dans le mouvement de traduction que cite Bachir. La différence serait, au plus, dans la nature intrinsèque ou extrinsèque de la relation sujet-prédicat, et non dans l’opération d’assemblage ou de répartition des existants qui semble pourtant plus décisive tant pour le raisonnement logique que pour les jugements ontologiques.
Il est toutefois important de noter que même s’il estime que traduire d’une langue « à copule » à une autre qui ne l’est pas n’est pas « indifférent », Bachir s’oppose à l’idée que « les philosophies sont (…) des systèmes de pensée séparés, constitués par des langues et des philosophies grammaticales radicalement différentes ».[ii] Cela dit, d’où vient même cette nécessité de faire un détour par les rapports logiques entre termes et relations contenus dans la grammaire, comme si cette dernière donnait à la langue son unité ? L’argument que nous défendons ici, c’est que même en répudiant un relativisme logique qui serait favorisé par les langues, l’auteur se sert du même postulat implicite quant à ce qui fait l’unité d’une langue. En effet, l’un des réquisits de l’amplification de la traduction chez Bachir est de retrouver l’unité de la langue à partir des structures linguistiques qui surplombent les différences culturelles dans les usages d’une langue.
Conséquences analytiques
Gilles Deleuze et Félix Guattari sont allés jusqu’à affirmer une unité politique de la langue est politique.[iii] Ce choix a au moins le mérite de ne contenir aucune pétition de principe. En outre, elle suggère que les représentations du monde partagées au sein d’une communauté politique ne sont pas simplement des facteurs supplémentaires qui influent sur la langue, mais bien des éléments constitutifs de celle-ci. La question fondamentale ici est : comment, dans une analyse qui donne à la traduction une grande amplitude, les continuités et les scansions "politiques" de la langue en viennent-elles à être occultées par une structure abstraite qui, bien que donnant à la langue son unité, en est aussi déduite ? Qu’une telle structure soit syntaxique, phonologique ou lexicale, elle jouit du même privilège de surplomber les différences qui naitraient d’usages culturels dominants ou politiques d’une langue. Dans l’analyse de Bachir, le niveau syntaxique semble bien jouer ce rôle.
Traduire, c’est comparer. Comparer suppose l’existence préalable des choses à comparer. Traduire crée ou maintient donc le caractère discret des choses qu’elle met en rapport. Il n’est d’ailleurs possible de parler d’hybridation qu’au sujet de choses qu’on tient pour séparées ou différentes. De plus, la conséquence de donner une représentation explicite ou une positivité à la traduction (qui n’a pourtant de forme d’expression ou de positivité que dans les langues particulières), c’est de recourir à des termes (langues) dont l’unité parait d’abord syntaxique.
Amplifier la traduction comme relation comparative a dès lors pour conséquence d’amplifier l’unité à partir de laquelle on procède à la découpe des termes à « mettre en rapport ». Une pragmatique de la langue aurait pu par contre envisager la traduction entre usages sociaux différents d’une même langue ou entre discours ontologiques mettant différemment l’accent sur des possibilités logiques universelles. Le concept de schème chez Kant et Bergson, repris ensuite par Piaget, pourrait bien renvoyer à la nature de ces représentations logiques socialement acquises[iv] qu’il s’agirait d’exposer dans le cadre d’une pragmatique de la langue. Cela nous mène vers une question qui prend une allure foucaldienne : quels sont les bords extérieurs de la traduction ?
Le dehors de la traduction
A la question de savoir ce qu’il y a en dehors de la traduction, la lecture de l’essai de Bachir nous renvoie à des choix conscients, réflexifs : l’hospitalité, la charité, l’éthique, la (lutte contre la) domination et les inégalités... En bref, en dehors de la traduction, il y a l’humain conscient, logique, rationnel, charitable, égalitaire. Sans doute ! Mais la première limite de cette échelle d’analyse, c’est que c’est à peine qu’elle est en mesure de rendre compte des pratiques sociales de traduction qui affleurent très peu la conscience et sont incorporées par les agents sociaux sous forme d’automatismes (ou de schèmes pratiques voire d’habitus dans une certaine mesure).
Pourrait-on expliquer la relative stabilité du système de traduction des patronymes maliens et sénégalais, en imaginant seulement des choix conscients ou des délibérations individuelles qui réouvriraient à chaque fois le registre des interprétations collectives ? Comment saisir la relation de la traduction aux rapports économiques ou politiques, aux savoirs formels relativement autonomes, à toutes ces choses situées en dehors d’elle et qui font d’elle une pratique positive supra-individuelle, avec ses modalités dominantes et ses règles de transformation ? Comment la traduction arrive-t-elle à s’autonomiser, à ne plus avoir besoin d’un dehors politique ou économique, à n’être plus que « technique » référée à elle-même ?
L’humanité envisagée comme horizon de la traduction permet sans doute de rendre compte de choix individuels remarquables, à l’instar de certains actes posés par les interprètes indigènes dans l’espace colonial. Usant de la différenciation latourienne entre médiateurs et intermédiaires, Bachir nous dit que ces interprètes sont bien dans le premier lot, car ils ne se contentent pas seulement d’être les véhicules passifs des mots qu’ils rendent dans la langue du colon ou dans la leur. Ils en transforment parfois le sens de façon délibérée, mais en prenant en compte de la totalité de la situation. Acte de sincérité même ! Mais l’on voit toujours mal comment un tel niveau d’analyse permettrait en même temps de rendre compte de la spécificité historique des modalités de la traduction ainsi que des mécanismes qui en sous-tendent la transformation.
Traduire les images
Les « translations de l’art africain classique » sont une occasion pour Bachir de mettre en relief l’impact qu’ont eu sur le cours du modernisme artistique les objets d’art africain dont il dit que « leur vivacité a signifié qu’ils ont trouvé à se loger dans de nouveaux langages, devenant ainsi des médiateurs et faisant de leurs traducteurs aussi des médiateurs ».[v] C’est pourquoi l’auteur ramène au premier plan le langage des formes que parlent ces objets, bien avant la fonction rituelle à laquelle il est commun de les réduire.
Il est vrai qu’on ne saurait accorder une fonction unique à ces images, comme si elles perdraient de leur plénitude sans les contextes ayant vu leur naissance. Cependant, en plus des traits formels, il y a toujours un dispositif par lequel l’objet arrive à signifier, le musée étant lui-même un de ces dispositifs. De plus, les traits formels, parce que limités dans leur combinatoire, n’ouvrent que des possibilités de langage, mais ne parlent aucun langage direct.
On pourrait se servir comme exemple la manière dont la figuration des fondateurs de cercles soufis et des rois-héros nationaux au Sénégal correspond schématiquement à la différence panofskienne entre la fonction commémorative et la fonction glorifiante des images (portraits). S’il est commun de représenter le héros (comme Lat Dior) de profil, le guide-fondateur est souvent représenté sous une vue de face. Que certaines images des fondateurs de cercles soufis soient photographiques n’a pas beaucoup d’importance ici, dans la mesure où même dans la photographie, la façon dont on traite le champ, sa profondeur, sa mise en relief et son animation fait l’objet de choix figuratifs.
Les images de Lat Dior, bien moins présentes dans les maisons sénégalaises que les portraits des fondateurs de cercles soufis, sont souvent chargées de détails contextuels. Lat Dior est non seulement souvent représenté de profil, mais parfois aussi accompagné de son cheval, avec un aide à côté et bien des objets qui enrichissent la scène figurée. Les choix formels permettent ainsi de contenir les relations (les interactions) dans l’image.
Or, la relative neutralité du fond de l’image la plus utilisée de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est de surcroît représenté sous une vue de face, ouvre la possibilité d’une relation (d’une interaction) entre l’observateur et l’image. Là où l’image de Lat Dior peut remplir une fonction commémorative, celle du fondateur du mouridisme ouvre, de par le face-à-face intersubjectif qu’elle permet, la possibilité d’une vénération. La fonction glorifiante d’une telle image est, en outre, renforcée par une idéalisation du modèle, facilitée dans ce cas par le turban maure du cheikh qui couvre la moitié du visage, réduisant ainsi le nombre de traits à imiter et laissant peu de place à un décalage important entre les diverses reproductions.
Cela dit, il arrive bien que les figurations de fondateurs de cercles soufis ou de rois-héros nationaux donnent à voir des fonctions différentes de celles qu’elles remplissent de façon habituelle. Dans les cercles soufis par exemple, le recours à l’image commémorative n’est pas rare, mais sert surtout de medium pour établir des prescriptions normatives quant aux rapports entre le guide religieux et le disciple, à l’importance de la patience dans le cheminement du soufi etc. Cependant, la distribution sociale de ces images commémoratives des fondateurs de cercles soufis parait très limitée.
La différence dans la façon de figurer fondateurs de cercles soufis et rois-héros nationaux est tout à fait envisageable à partir de la différence des régimes d’existence post-mortem dans lesquels se trouvent les deux types de personnages. Car si les rois-héros nationaux sont littéralement des figures historiques, les fondateurs de cercles soufis sont, en général, des êtres dont la présence continue à être actualisée grâce, entre autres, à ces images dont les traits formels leur permettent d’entrer dans le dispositif relationnel extérieur à la toile ou à la photo. La question fondamentale consiste donc moins à se demander si l’objet d’art ou l’image de manière générale garde une « vivacité » sans le dispositif qui l’a vu naitre, que de savoir la variabilité logique et réelle de la relation entre l’objet et un dispositif auquel il est forcément inséré.
Ainsi est-il peu certain que le transfert du célèbre portrait de Cheikh Ahmadou Bamba dans un musée d’ici ou d’ailleurs puisse conserver cette fonction dite « glorifiante » sans le dispositif et les codes d’interprétation qui permettent à l’observateur d’établir la relation intersubjective avec l’image. De l’autre côté, avec des relations contenues dans le cadre, l’image de Lat Dior garderait plus ou moins sa fonction commémorative dans un mouvement de translation similaire. Dans un cas, le pouvoir de l’image est relatif (au sens que ce qualificatif a dans "pronom relatif") ; dans l’autre, le pouvoir de l’image lui est intrinsèque.
Il faut enfin reconnaître que Bachir ne soutient guère l’idée que toutes les traductions se valent, mais c’est une question que nous étions bien amené à nous poser au cours de la lecture. La conclusion y apporte une réponse ferme, notamment lorsque l’auteur oppose les traductions violentes aux traductions hospitalières, « qui ont le souci de la fidélité par véritable souci de connaissance de l’autre ».[vi] Nous espérons que la présente traduction aura reflété ce souci, malgré le fait qu’elle amplifie quelques traits de l’ouvrage et en contracte bien d’autres.
[i] Diagne, Souleymane B. De langue à langue. L’hospitalité de la traduction (Albin Michel, 2022), 121-22.
[ii] Ibid., 129.
[iii] Deleuze, Gilles, et Félix Guattari. Mille Plateaux (Éditions de Minuit, 1980), 109.
[iv] Il est important de souligner que le fait de relever le caractère acquis des représentations logiques ne veut pas dire que celles-ci puissent être exclusives à un groupe social. Au contraire, un « acquis » est à entendre comme un « nécessaire » de la cognition humaine.
[v] Diagne, op.cit., 87.
[vi] Ibid., 164.















