REPENSER L'ACCES A LA TERRE
L’urbanisme social1, réflexion visant à créer des espaces urbains inclusifs et équitables, se heurte aujourd’hui à un défi majeur : la disponibilité foncière. Dans un contexte de croissance démographique et d’étalement urbain...
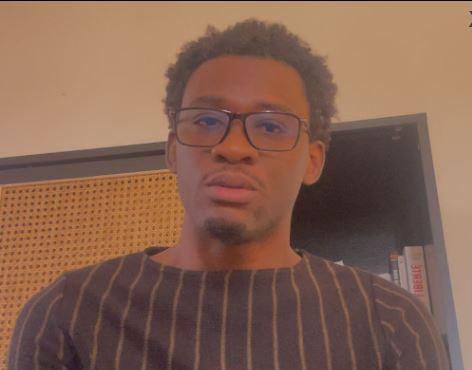
L’urbanisme social1, réflexion visant à créer des espaces urbains inclusifs et équitables, se heurte aujourd’hui à un défi majeur : la disponibilité foncière. Dans un contexte de croissance démographique et d’étalement urbain, la question de l’accès à la terre2 devient un enjeu central pour la conception urbaine. La rareté des terrains disponibles en ville, couplée à la spéculation immobilière et la dépossession foncière, complique la mise en œuvre de projets sociaux et durables.
L’urbanisme social vise donc d’un point de vue anthropologique3, à concevoir et à transformer les espaces urbains en tenant compte des dynamiques sociales, culturelles et symboliques qui structurent les communautés humaines. Il s’agit d’une approche qui place les usagers et leurs pratiques quotidiennes au cœur de la réflexion urbanistique, en reconnaissant que l’espace urbain n’est pas seulement un cadre physique, mais aussi un produit social et culturel.
Les résultats de l’enseignante chercheuse Françoise Navez-Bouchanine4 sur les pratiques habitantes et les représentations de l’espace mettent en évidence la nécessité d’une approche anthropologique, pour comprendre les besoins et les aspirations des populations. L’urbanisme social, ainsi envisagé, devient un outil de rationalisation plus adapté aux réalités sociales.
De plus, comme le montre Henri Lefebvre5, l’espace urbain est le résultat d’interactions complexes entre les individus, les groupes sociaux et les institutions. Il est à la fois un lieu de conflits, de négociations, de cohabitation, d’identité et d’appartenance. Et donc, ces engrenages devront davantage être prisent en compte pour freiner la dépossession souvent capitaliste.
Ces réflexions invitent à repenser les mécanismes d’acquisition et de répartition des terres pour favoriser un urbanisme plus juste et accessible.
En ce sens cet article explore les défis liés à la déficience conceptuelle, à une dépossession flagrante et a une nécessaire reconceptualisation.
La Terre : une déficience conceptuelle
¨La terre appartient à peu de gens qui y vivent aujourd’hui, à beaucoup de gens qui y ont vécu hier et à d’innombrable gens qui vont y vivre demain¨ n’est-ce pas là une piste de réflexion pour repenser fondamentalement notre conception sociale du foncier ?
La terre, en tant que ressource fondamentale, a joué un rôle central dans l’évolution des sociétés humaines. Loin d’être un simple support physique, elle constitue un espace6 chargé de significations culturelles, sociales et symboliques. Une approche anthropologique permet de comprendre comment les relations des humains à la terre ont façonné leurs modes de vie, leurs organisations sociales et leurs systèmes de valeurs.
Dans de nombreuses sociétés, la terre est bien plus qu’un espace de production : elle est le fondement des identités collectives. Pour exemple, Claude Lévi-Strauss7, décrit comment les peuples autochtones d’Amazonie entretiennent une relation intime avec leur territoire, perçu comme une entité vivante et sacrée. Cette conception holistique de la terre contraste avec la vision utilitariste des sociétés industrialisées.
La conception africaine de la terre est également marquée par une forte dimension communautaire. Contrairement à la notion occidentale de propriété privée, la terre est souvent considérée comme un bien collectif, géré au profit de la communauté et des générations futures. Ce principe est bien illustré par le concept de Ubuntu, qui met l’accent sur l’interdépendance et la solidarité entre les membres d’une communauté.
Le philosophe Paulin Hountondji8 souligne dans ces travaux que cette gestion communautaire de la terre repose sur des systèmes coutumiers complexes, où les chefs de terre (appelés LAMANE dans la tradition sénégalaise) ou les conseils de village jouent un rôle central dans l’attribution et la régulation des droits fonciers. Ces systèmes, bien que souvent informels, ont permis de maintenir un équilibre entre les besoins des individus et ceux de la collectivité. D’ailleurs au Sénégal la réforme foncière la plus audacieuse a été initié au temps du royaume du Baol, appelé ¨réforme foncière du Teigne¨ Thiendella Ndiaye. Ce dernier va mettre fin à des expropriations et accaparement des autres lamanes avec violence pour redistribuer de manière équitable les terres du Baol donnant naissance à des villages comme Djack, Ngoundiane…
Aujourd’hui ce qu’on constate est qu’à cause de la globalisation et de l’exploitation intensive, le rôle premier de la terre qui doit être d’assurer la survie existentielle des peuples est menacée.
Au Sénégal les communes lébous9 (Ouakam, Ngor, Yoff) à Dakar ont tous été dépouillées de l’essentielle de leur terre par appartenance communautaire pour les octroyé très souvent à des privilégiés sociaux. Alors que ces communautés traditionnellement très organisées avec des mécanismes sophistiqués ont vu brutalement leur mode d’organisation être remplacé par un autre système de propriété totalement extérieur. Donnant ainsi l’exclusivité absolue de la propriété foncière à des organisations extérieures totalement inégalitaire créant ainsi des défavorisés, que Levebvre10 vas appeler le précariat social pour remplacer traditionnellement le prolétariat. Ce précariat va ainsi encourager une occupation désagencée de nos espaces communes en ville. En 2024 le docteur Ibrahima Malick Thoune avait écrit un article11 critiquant la bordelisation de nos villes. La décomposition des mécanismes sociale, sur la distribution de la terre vas donc accroitre les inégalités sociales créant des groupes d’intérêts (Administrateurs, hauts cadres de l’Etat, Multinational, religieux, chef coutiers…) autour du foncier. De même la quasi inaccessibilité au foncier pour la plupart des communautaires et des résidents faisant du logement social un réel défi non pas structurel mais foncier. Au Sénégal c’est devenu banal qu’un individu dispose de plusieurs domiciles dans un même quartier ou commune tandis que la plupart des gens n’ont pas les possibilités de se payer un terrain. Le massacre foncier de Mbour-412 doit tous nous interpeller sur les politiques foncières. La révélation expose une chose dans le fond, comment une minorité s’accapare des biens de tous dans une politique de marché.
Cette politique de marché nous aura montré par dépossession comment la communauté autochtone de Ndingler13 va être privé et sa condition d’existence sociale et de survie. Ce cas expose comment par la politique de l’exclusivité absolue sur la terre, les zones rurales sont autant exposées que les zones urbaines.
Nos Etats doivent reconceptualiser la terre au service du social, de la vie et de la continuité. La considération juridique du foncier actuelle est un scandale qui a suffisamment montré ces limites. En 2024 un promotionnaire Hugues Alexandre avait fait un article13 sur la question des litiges foncier au Sénégal, qui est exemple de la limite juridique du foncier.
Pourquoi un natif d’une communauté, d’un Etat ou pays donné devrait payer pour acheter la portion de terre qui devra lui servir de domicile ?
Rien n’explique une telle absurdité si ce n’est pour des raisons capitaliste. Le droit à la terre devrait être une obligation sociale et non une question de moyen. Je pense d’ailleurs qu’il est impossible de régler au Sénégal la question des logements sociaux15 tant que le foncier n’est pas réglé, dans le sens d’en faire bien de tous dont le monopole commercial ne reviendrai qu’a l’Etat. Dans le cas contraire, cette considération capitalistique du foncier va faire accroitre la dépossession.
LA Terre : Capital, une dépossession flagrante
¨En réalité si vous ne comprenez pas la notion de capital, vous ne connaissez pas la valeur de la terre¨
Karl Marx16 nous explique que la terre n’est pas simplement un bien physique ou un facteur de production, mais un élément clé des rapports sociaux de production. Ainsi il met en lumière les dynamiques de pouvoir, d’exploitation et de lutte des classes qui se nouent autour de la propriété et de l’usage de la terre.
Pour lui, la terre est avant tout un moyen de production17, au même titre que les machines, les outils ou les infrastructures. Elle est essentielle à la production agricole, minière, immobilière et industrielle, et donc à la reproduction18. Cependant, contrairement aux autres moyens de production, la terre possède une caractéristique unique : elle n’est pas le produit du travail humain. Elle est une ressource naturelle, un don de la nature, mais son accès et son utilisation sont déterminés par les rapports sociaux. Il distingue la terre en tant que ressource naturelle de la terre en tant que propriété. Sous le capitalisme, la terre est privatisée et devient une marchandise, soumise aux lois du marché. Autrement dit, Marx nous révèle deux (2) fonctions centrales de la terre, sa fonction naturelle d’assurer la survie et sa fonction de moyen de production privatisée avec la conception du capitalisme.
Au Sénégal, le cas Ndingler illustre comment la dépossession foncière est légitimée avec une instrumentalisation du droit Sénégalais. Dans son article qui date de 2023 OpenEdition Journal19 a fait une exposition approfondie du scandale de Ndingler. Ce cas nous montre comment trois cents (300) ha situés dans le village de Djilakh vont être octroyé au plus grand firme de production de poulets et d’œuf du pays SEDIMA. Babacar Ngom va ainsi appliquer une des principes les plus efficace du capitalisme de production, la dépossession foncière. Imaginez-vous 300 ha utilisé par des populations communautaires pour habiter et cultiver se retrouve légalement entre les mains d’une seule personne. La violence de la dépossession foncière est cynique, elle prive un besoin non seulement essentiel pour la survie et aussi pour la production a tout une communauté, pour l’octroyé à une seule personne généralement.
Mais faisons l’historique de Ndingler, Babacar Ngom a été titré par délibération communale en Décembre 2012 et par titre foncier matricule 2247/MB en 2019. Alors que la communauté autochtone de Ndingler a au moins vécu sur ces terres par continuité générationnelle au moins 100 ans. Et c’est là, la violence de la dépossession capitaliste, elle ne vous arrache pas que votre moyen de survie, d’être, de production, de travail. Mais elle vous arrache votre histoire, votre passé, votre culture, votre tradition en deux mots VOTRE TOUT.
Au Sénégal on l’appelle le vieux de Ndingler20, lors d’une conférence de presse il dira ¨nous nous sommes toujours opposés à ce projet. Un jour, vers 2016, Babacar Ngom accompagné de son fils et du chroniqueur de lutte Khadim Samb étaient venus ici, c’était une matinée. Ils nous ont promis de l’électricité, de l’eau et la construction d’une route pour désenclaver notre localité ainsi que de l’emploi pour lutter contre la pauvreté si nous acceptons la réalisation du projet¨
Ces propos révèlent la vulnérabilité sur laquelle s’appuis généralement le système capitaliste, renforcé par des politiques libérales favorisant la dépossession foncière. Très souvent c’est cela les promesses, une amélioration des conditions de vie, un bon marché de travail, et de l’empois.
Mais en vrai ceux sont nos Etats qui montrent leurs limites (surtout juridique) et leur échec dans la conception de ce qu’on appelle urbanisme social. La considération du foncier comme un marché privé et l’absence de cadre juridique forte qui place le communautaire au cœur du foncier est en effet le plus grand défi en milieu rural. La privatisation de terre rurale est une limite assez visible pour la réformer. Car non seulement elle crée une possibilité légale de dépossession foncière, mais aussi encourage la corruption foncière. Il nous faut aussi définir c’est quoi une zone rurale, non pas par disposition géographique ni que démographique, mais par utilité de production agricole et industrielle. Cela permettra de donner un sens à la ville rurale et de verrouiller avec toute possibilité de modernité les structures communautaires rurales. Il y’a deux (2) semaines le Burkina a voté une loi interdisant l’achat de terres rurales à tous étrangers, une loi que peu de gens ont bien compris le sens et la portée. Une bonne initiative qui vise à protéger les zones rurales de la dépossession du capitalisme des multinationales. Mais cela est insuffisant, il faut aller plus loin pour la protection des communautés rurales, par exemple, limité la superficie pour les non résident avec une utilité agricole ou industrielle. Sinon deux (2) dangers nous guettes la dépossession par les multinationales étrangers et l’accélération de la vulnérabilité des communautés autochtones.
Ainsi, le procédé le plus visible et le plus efficace du capitalisme est la dépossession foncière des communautés locales ou paysannes. Les processus d'accaparement des terres, souvent légitimés par des lois favorisant les intérêts privés, privent les paysans, les peuples autochtones et les travailleurs ruraux de leur accès aux ressources naturelles. Cette dépossession entraîne une exclusion sociale et économique, poussant de nombreuses personnes vers la pauvreté et la marginalisation. Au Sénégal 80% des travailleur ruraux sont des femmes alors que ces dernières ne détiennent que 2% des propriétés foncières. Cela pour dire que ce qui travaillent la terre n’en ont pas accès alors qu’elles sont les vraies créatrices du profit suivant la production. Tout ceci n’est qu’injustice, mais aussi une mauvaise politique urbanistique. L’enseignante marocaine Mme Navez-Bouchanine n’a cessé de nous exhorter de rétablir le pont entre les réalités et la technique.
David Harvey21, explique de par le concept d'accumulation par dépossession comment le capitalisme s'approprie les terres et les ressources communes, souvent par la force ou par des réformes légales donc juridique. Ce processus déstructure les communautés locales et renforce les inégalités sociales.
Pour comprendre ce que dit David Harvey dans le ¨nouvel impérialisme¨ il faut analyser deux (2) cas, celui d’ERAMET a Lompoul et de TERANGA GOLD à Sabodala.
ERAMET une entreprise Française dans le domaine minier, qui entre dépossession des terres, destruction de l’environnement, épuisement des ressources en eaux quoi d’autre pour parler de scandale sur la terre. Après avoir saccagé les terres de Diogo au nom de la production, aujourd’hui ERAMET à travers son filiale GCO est en train de détruire, d’exclure tout une communauté a Lompoul. En janvier 2025 le journal les reporterre21 a fait un article sur le cas ERAMET. Elle seule, à une concession de 445 000 ha sur une longueur de 100 Km de littoral. En observant le cas de GCO a Lompoul on se rend compte de la destruction du désert historique et culturel, de la dépossession des terres agricoles et d’habitat, du transfert des communautés rurales vers d’autres terres inconnues et du saccage de l’environnement. Car GCO épuise 80% des nappes d’eau dans toute la zone. Tout ceci dans l’exclusion total des populations autochtones dans la répartition des profits. Ainsi GCO expose doublement les populations de Lompoul. Non seulement en faisant accroitre leur vulnérabilité, mais aussi à un déséquilibre environnemental condamnant totalement les zones rurales concernées.
Mais en matière d’accaparement par dépossession minière, le groupe TERANGA GOLD OPERATION (TGO) à Sabodala est l’exemple le plus parlant. En 2016 des révoltes populaires vont conduire à la médiation d’une des plus grandes mines du Sénégal. Les populations de Sabodala sont tous exposées dans l’ensemble de ce qui fait leur existence à être déplacé. Les villages, les champs, les commerces jusqu’au cimetière doivent tous être délocalisés pour la production. Un article de la maison des reporters23 à la date va exposer l’une des plus grandes séquestrations foncières du Sénégal. Mais une déclaration d’un communautaire a attiré mon attention, il dit ¨95% des terres fertiles pour l’agriculture dans cette zone sont occupées par les sociétés minières. Les gens n’ont pas de quoi vivre¨. La dépossession qu’a fait TGO est cynique, mais vous n’êtes pas encore surpris non, car l’accaparement foncier de TGO au cours des dernières années est encore plus choquant. Saviez-vous que TGO fait dix (10) fois la superficie de Dakar, oui je dis bien 10 fois. Car après leur dernière concession en 2020 TGO détient à lui seul 5 850 Km². Cela nous permet de comprendre le cri des communautaires lorsqu’ils disent que 95% des terre agricole sont accaparées par les sociétés minières. Et le plus souvent quand ces populations se révoltent, ils sont violemment réprimés par les forces publiques, dés fois même jusqu’à mort d’hommes.
Je n’essaie pas de dire qu’il ne faut pas exploiter les ressources tel que minières. Non, mais il est impératif de placer les communautés au cœur des exploitations, car ils sont le début et la fin. Ces populations dépossédées de leur terre naturelle de survie et de travail sont cela qui vont migrer dans les villes surtout les capitales ou la politique foncière est encore plus violente, pour se trouver du travail. Les communautés doivent donc être les moteurs de toutes politiques de production dans les zones rurales. Il ne s’agit donc pas de les employer, mais de les intégrer dans la gestion des exploitations minières, avec une répartition équitable des profits et une gestion concertée de la terre. En ce sens, il faut adopter d’autre formes d’approche conceptuel avec les communautés.
La Terre : une nécessaire reconceptualisation collective en zone rurale et urbaine
Il est bien possible de mettre en place ce que j’appelle ici le conseil communautaire, dans le but d’intégrer dans la gestion des terres, la répartition des profits, et les décisions d’entreprise les communautés autochtones. La nouvelle forme politique appelée ¨El communard¨24 noté dans les pays d’Amérique latine ou la révolution Bolivar est passé (Bolivie, Cuba, Venezuela) montre que c’est bien possible de faire une construction communautaire de la terre en fonction des besoins (agricoles, infrastructurel, industriel…) et de la disponibilité.
Le conseil communautaire est une piste de solution en milieu rural qui consiste à organiser les communautés comme des institutions locales. Le but est de donner le pouvoir de la gestion des terres aux communautés autochtones. Ainsi il sera impossible pour qui que ce soit de vendre des terres. Le conseil lui-même ne pourra vendre les terres, mais la mission de la gestion lui reviendra, dans l’utilisation des terres et de sa distribution. Ainsi, il va falloir pour tout entrepreneur motiver son besoin foncier par un projet agricole et/ou industriel inclusif. Validé par le conseil communautaire, l’octroi ne fait nullement de lui le propriétaire de la terre. Car au moment où le projet prend fin les terres seront d’office récupérées par les communautés. Cela permettra de lutter contre la dépossession des terres comme à Ndingler. En zone rurale minière le conseil communautaire aura deux (2) rôles à jouer au-delà de la gestion des terres. La répartition équitable des profits, qui consiste pour l’entreprise minière en guise de compensation d’octroyer entre 15% et 20% de son chiffre d’affaire net au conseil communautaire qui se chargera de la répartition. Aussi de participer aux décisions des entreprises sur la terre. Pour une planification des zones d’exploitation, et une meilleure prise en compte des besoins de terre pour l’agriculture des populations autochtones. Avec ce modèle l’Etat pourra décentraliser la gestion du foncier au niveau des conseils, avec une interdiction de commercialiser les terres et de définir ce que j’ai appelé ici ville rurale quelque soit le niveau de modernité.
Dans les villes urbaines où la densité démographique est très élevée il faut concevoir le foncier collectif a l’exemple du model ¨EL communard¨. Cela permettra d’arrêter l’accaparement foncier de par les spéculations immobilières. Le foncier collectif permettra dans des zones comme les communes lébous d’établir des terres collectives pour la communauté. Non pas pour faire une distribution foncière, mais de concevoir des projets immobiliers social avec des immeubles à plusieurs appartements pour ces communautés. Le foncier dans ce sens n’appartiendra à aucun individu, mais sera un bien collectif dont ¨la communard lébous¨ se chargera de la distribution équitable des appartements via un projet immobilier adapté. Avec le modèle communard l’Etat pourra assurer une politique foncière pour tous avec l’établissement de foncier collectif, mais aussi en planifiant le foncier d’habitat dans chaque région. Cela permettra dans le cours, moyen et long terme de mettre à disposition dans les régions des zones d’habitats gratuitement.
Enfin l’Etat doit revoir son cadre juridique et urbanistique, établir des conditions de ruralité et faire du commerce foncier un monopole exclusif de l’Etat dans le but de l’abolir.
Dans cet article j’ai exploré l’urbanisme social dans un but, la reconsidération du foncier au profit des communautés, de la conception anticapitaliste et des limites du cadre juridique néolibérale. Il s’agit donc, de stopper la dépossession capitaliste et de faciliter la propriété aux communautaires.
Il est essentiel de repenser aujourd’hui humainement la question de la propriété foncière, de ne pas en faire une exclusivité individuelle mais un bien collectif enfin.













