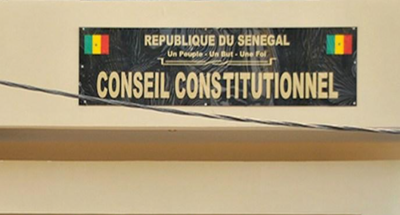LE QUAI BRANLY EST "TROP BLANC"
Le 9 janvier, après 21 ans à la tête du Musée du Quai Branly, Stéphane Martin quittera ses fonctions de président de cet établissement voué aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques et voulu par Chirac. Il fait le bilan

« Nous sommes trop blancs », estime Stéphane Martin, qui quittera, le 9 janvier, la présidence du musée.
A l’heure de quitter votre poste, quelle est, selon vous, l’une des grandes réussites du musée ?
Le désir d’ouverture et de tolé rance que nous portons depuis les débuts de l’établissement. Nous avons toujours laissé une liberté totale aux commissaires venus de tous les horizons, avec parfois des approches et des théo ries totalement différentes de celles des curateurs maison. C’est une des choses dont je suis le plus reconnaissant à l’équipe de con servation du musée. Cela n’existe quasiment nulle part ailleurs.
Comment définiriez-vous la spécificité du Musée du quai Branly ?
Je pense que la première sur prise aura été que l’on s’attendait à un grand musée pour les ama teurs, comme le sont les départe ments Afrique et Océanie du Metropolitan à New York et non à un établissement très ouvert à tous les types de regards qui peu vent se porter sur les cultures non occidentales. Il est exceptionnel qu’un musée ose donner autant de place à des expositions temporaires – et des expositions dont les commissaires sont exté rieurs au musée.
Sa création s’est aussi faite de manière originale...
Oui, car il n’y a pas eu d’établis sement de préfiguration. Le musée a été créé, avec tous ses droits, mais sans collection, ni lieu. C’est une situation à la quelle se compare seulement celle du Centre Pompidou : une création qui n’a pas été préparée de longue date par l’administration, qui naît d’une volonté politique au plus haut niveau et qui bouscule les habitudes. Je dois dire que nous étions alors dans une période de cohabitation et que notre projet était regardé avec sympathie par Lionel Jospin, alors premier ministre, si bien qu’il y avait une sorte de pacte tacite : « Pas de crises, pas de révolution de palais à l’intérieur de votre équipe, pas de drames et tout se passera bien. »
Le musée est-il né sous la protection de Jacques Chirac ?
C’est un peu plus compliqué que ça. Jacques Chirac avait une grande expérience de la haute administration, il avait pu observer la manière dont les choses s’étaient passées du temps de François Mitterrand – souvent dans la difficulté et les affrontements. Il y a eu relativement peu de réunions à l’Elysée, mais une concertation constante entre la présidence, le premier ministre et les ministres de la culture successifs. Mais il est vrai que nous avons été préservés des interventions parfois envahissantes des cabinets ministériels. Jacques Chirac voulait créer un choc symbolique et moderniser le rapport à ces arts, en échappant aux habitudes de pensée du primitivisme et en les montrant comme des arts en euxmêmes. Et non comme les références de Picasso, Derain ou des surréalistes.
Le musée a accueilli 1,3 million de visiteurs en 2018. Est-ce satisfaisant ?
Nous pouvons être assez fiers des résultats. En dehors de l’année d’ouverture, où nous avons eu 1,7 million de visiteurs, la fréquen tation a varié entre 1,2 et 1,45 million de personnes. C’est l’un des chiffres les plus importants pour un musée de ce type, à l’exception du TePapa Tongarewa Museum, à Wellington (Nouvelle Zélande), qui est un cas très particulier, et du Musée d’histoire naturelle de New York – mais ses visiteurs n’y viennent pas seulement pour ses collections indiennes. Ici, de sur croît, le contexte est très différent : l’idée initiale était d’ajouter un musée dans un ensemble pari sien déjà très riche et prestigieux. Une pierre nouvelle à un édifice qui jusquelà se consacrait pres que exclusivement – pas en tota lité heureusement – aux cultures indo-européennes.
Qui sont les visiteurs du Quai Branly ?
Trois publics cohabitent : scolaires, les gourmands de musées et un public qui ne vient qu’au Quai Branly, avec une majorité de gens jeunes, les uns issus des émigrations, les autres venus chercher les racines de leurs goûts : les chants inuits, le ta touage maori... Notre difficulté est moins de faire venir de nouveaux publics que de faire qu’ils reviennent. Les Parisiens ne forment qu’un tiers des visiteurs et ce que l’on peut regretter, c’est le taux relativement faible de touristes, jamais plus de 20 % alors que nous sommes au pied de la tour Eiffel.
Comment l’enrichissement des collections s’effectue-t-il ?
Il y a les acquisitions directes financées par la dotation budgétaire qui nous est attribuée à cette fin et par un petit pourcentage prélevé sur nos recettes, soit près de 1,5 million d’euros par an. Les dations sont une source importante, ainsi que les donations, à l’image de celle de Marc Ladreit de Lacharrière en 2018, exception nelle par sa richesse. C’est une politique ouverte au grand large, hé ritière d’une très longue histoire commencée au Cabinet des médailles du roi. Ce qui nous impose du reste des devoirs. Un exemple : la France est l’un des seuls pays à avoir constitué très tôt une collection de peintures aborigènes d’Australie. Cela nous commande de la poursuivre, de la maintenir en vie. Autre exemple : nous sommes les héritiers du Musée des colonies, avec ce qu’il y a là d’insupportable aujourd’hui par rapport à l’histoire de la colonisation. Mais cela nous impose d’y travailler, de la compléter à des fins historiques.
Les enjeux politiques sontils plus forts ici que dans d’autres musées ?
Pendant les premières années, on m’a beaucoup posé la question : allez-vous être un musée scientifique ou esthétique ? Je suis reconnaissant à Jacques Chirac car il nous a beaucoup protégés d’une fonction de célébration diplomatique. Nous avons toujours gardé une liberté complète de programmation vis-à-vis de nos tutelles.
La question des restitutions des œuvres occupe désormais une place centrale. Vous vous êtes opposé aux conclusions du rapport Savoy-Sarr qui prône une « restitution définitive et sans condition d’objets du patrimoine sur le continent africain ». Pourquoi ?
Au terme de restitution, je préfère celui de partage. La question de la propriété ne doit pas être négligée, mais le plus important est que les collections doivent être accessibles et partagées. Les transferts de propriété sont souhaitables dans des proportions qui ne doivent pas être celles qu’implique le rapport SavoySarr, qui sont celles d’une autoflagellation et d’une repentance. Il existe des œuvres dont la symbolique est telle que la question de la restitution ne se pose pas. Il faut donc définir des critères objectifs, faire la différence entre des pièces qui ont un statut tel que leur place n’est pas dans un musée et les autres. Mais déconstruire l’histoire de la collecte et des collections, c’est méconnaître ce qu’est une partie de l’histoire culturelle de l’humanité. Et je pense aussi que le musée n’est pas la réponse à tout. Il y a des moyens différents d’exprimer un sentiment patriotique. Le musée n’est qu’une réponse parmi d’autres.
Pensez-vous que le Quai Branly doit mener une politique d’expansion à l’extérieur de la France, comme le fait le Centre Pompidou ?
Dans quelques années, il y aura des Musées du quai Branly à l’étranger, j’en suis persuadé. Mais cela coûte beaucoup d’argent. Nous n’avons pas encore de demande, mais il y a des projets. C’est un problème de demande internationale. Notre musée a apporté ces cultures et ces arts là dans des pays où ils n’étaient jamais allés. Nous avons réalisé des expositions d’art africain en Chine, par exemple. Notre but, aujourd’hui, c’est l’Afrique. Nous l’avons fait à toute petite échelle car il manque des structures d’accueil. Cela va s’accélérer car le paysage muséal change considérablement. Des initiatives nationales et privées vont se multiplier. Je suis optimiste.
Les missions du musée doiventelles évoluer ?
Ce que je souhaite, c’est que le musée se « colorise », nous sommes trop blancs. Il est encore très compliqué de faire venir des conservateurs des pays d’origine. C’est l’étape d’après pour nous. Dans les musées australiens, néerlandais, ils ont franchi ce pas. Le fait que nous ayons aussi la tutelle du ministère de la recherche nous permet déjà d’accueillir des chercheurs du monde entier.