POLITIQUES DE L’INIMITIE
Politiques de l’inimitié (La Découverte, 2016) est le premier opus d’une trilogie du Camerounais Achille Mbembe – grand penseur de notre époque.
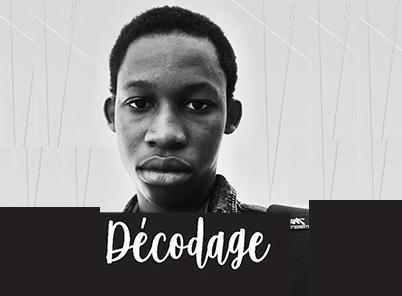
Politiques de l’inimitié (La Découverte, 2016) est le premier opus d’une trilogie du Camerounais Achille Mbembe – grand penseur de notre époque. Dans cet essai magnifique, et brûlant d’actualité, le lauréat du prestigieux prix Holberg 2024, y «explore cette relation particulière qui s’étend sans cesse et se reconfigure à l’échelle planétaire : la relation d’inimitié.» Il semble que la constitution d’un «monde hors relation», et littéralement fragmenté, est irréversible. Les différences, qui devraient être célébrées, deviennent des problèmes insolubles. Le réflexe d’appartenance à une tribu, qui est de l’ordre instinctif, domine celui de la conscience d’une humanité partagée et riche de sa diversité. En Europe, par exemple, les partis d’extrême-droite pullulent. Le rejet de l’Autre est un sport national. On cherche, par tous les moyens, à imputer aux étrangers la responsabilité des déconfitures des pouvoirs publics.
La figure de l’étranger, c’est-à-dire le «non-semblable», remplit une «fonction défensive» dans notre monde. Elle est celle qui n’appartient pas à la tribu, à la communauté ; celle dont la présence est nuisible, dissimulée ; celle qui se caractérise par son ubiquité, sa dangerosité, la menace permanente qu’elle représente. L’ennemi, qui «devrait être entendu dans son acception concrète et existentielle et non point comme une métaphore ou comme une abstraction vide et sans vie», est partout. Il représente un réel danger puisqu’il avance masqué, «sans visage, sans nom et sans lieu.» La menace, selon cet imaginaire d’un ennemi omniprésent, devient diffuse et mortifère. Elle justifie de ce fait toutes les violences exercées sur ceux que l’on considère comme nuisibles à la communauté – le musulman, la femme voilée, le Nègre, l’immigré, l’intrus, le juif, le réfugié, l’Arabe, pour n’en citer que quelques-uns.
La guerre, qui «aura été la matrice du développement technologique au cours des siècles précédents», est devenue le «sacrement de notre époque». Au sortir de la Grande Guerre, qui a été extrêmement traumatisante pour la mémoire collective, l’on s’est donné l’illusion de conjurer à jamais la guerre sous toutes ses formes. L’invasion de l’Ukraine par la Russie – qui est, aujourd’hui, dit-on, une menace pour la sécurité du Vieux Continent – est venue ébranler toutes les certitudes. Le mythe de la souveraineté, qui a longtemps été érigé en balustrade pour empêcher à certains États de s’attaquer à d’autres, est en train de s’effondrer. Mais, pis encore, la guerre se fait au milieu des populations civiles, causant ainsi d’innombrables victimes, principalement les femmes et les enfants.
Parallèlement à ces guerres entre armées régulières, surgissent, au sein des États, d’autres forces clandestines qui cherchent à affaiblir, voire à supplanter, ceux-ci. Il faut dire que la «guerre n’oppose plus nécessairement des armées à d’autres ou à des États souverains à d’autres. Les acteurs de la guerre sont, pêle-mêle, des États proprement constitués, des formations armées agissant ou non derrière le masque de l’État, des armées sans État mais contrôlant des territoires bien distincts, des États sans armées, des corporations ou compagnies concessionnaires chargées de l’extraction de ressources naturelles mais qui, en outre, se sont arrogé le droit de guerre.»
En Afrique subsaharienne, particulièrement, les factions terroristes – qui pèsent sur les «marchés régionaux de la terreur» du fait de leur «capacité de se déplacer sur des distances, d’entretenir des alliances changeantes, de privilégier des flux au détriment des territoires, et de négocier l’incertitude» – deviennent de plus en plus invincibles. Les pays de l’Aes, où les militaires ont arraché le pouvoir pour restaurer la sécurité, font face à cette montée en puissance meurtrière de ces groupes terroristes. Les victimes ne se comptent plus. Ces États dont les armées, squelettiques, et incapables d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ont décidé de faire appel à des mercenaires. Mais en vain. Cette impuissance devant les terroristes constitue, au fond, un anéantissement de l’idée de politique, gage de l’ordre et du progrès dans une communauté.
La «sortie de la démocratie» est aussi un des faits majeurs de notre époque. La crise de la démocratie est mondiale, profonde. La période de l’euphorie démocratique, après la chute de l’Union des républiques socialistes soviétiques (Urss), dans les années 1990, relève désormais de l’histoire ancienne. Les démocraties, dans leur fonctionnement, deviennent de plus en plus illibérales – c’est l’historien et sociologue français Pierre Rosanvallon qui parle, non sans oxymore, de «démocratie illibérale.» Le rétrécissement des libertés se manifeste, entre autres, par la manipulation des règles du jeu démocratique, la répression des voix dissidentes, les diverses mesures visant à torpiller la presse, l’interdiction systématique des manifestations, le non-respect du Droit, etc. L’utilisation excessive de la violence témoigne, en outre, de la tendance illibérale des démocraties contemporaines. Celles-ci, précise-t-il, «ont intégré dans leur culture des formes de brutalité portées par une gamme d’institutions privées agissant en surplomb de l’État, qu’il s’agisse des corps francs, des milices et autres formations paramilitaires ou corporatistes.»
L’essai se termine par un appel à habiter le monde ensemble, à «passer constamment d’un lieu à un autre», à tisser, avec les autres, un «rapport de solidarité et de détachement.» Pour ce faire, il faut développer une politique de l’en-commun, qui permet à tous les peuples du monde de s’insérer pleinement dans les «Circulations», avec «l’éthique du passant», sans être détestés, traqués et éconduits. En réalité, cette utopie révèle plus d’une obligation qu’un choix puisque le «monde n’ayant plus de pharmacie unique, il s’agit donc, véritablement, si l’on veut échapper à la relation sans désir et au péril de la société d’inimitié, d’habiter sous tous ses faisceaux.»
La lecture de ce texte, in fine, rappelle, et fort malheureusement, la manière dont, chez nous, le parti Pastef a fait de la haine un instrument politique. Le leader de cet avatar du populisme, conformément à sa vision manichéenne et étriquée du monde, a toujours présenté ses adversaires comme de la vermine. Il a vendu de la haine à ses inconditionnels. L’inimitié, avec ces gens là, est devenue une valeur ; elle est célébrée. L’ennemi est celui qui s’oppose à la moraline sociale dominante. Le lien social commence à devenir celui de l’inimitié. Notre pays devient, progressivement, pour reprendre Amin Maalouf de l’Académie française, une «jungle de haines où tout le monde se sent victime et voit autour de lui que des prédateurs.» Les nantis, accusés de tous les maux de Nubie, sont les prédateurs qui, avec la complicité de «l’élite corrompue», sucent le sang de la populace.
POST-SCRIPTUM : Notre pays a perdu le président du Conseil constitutionnel, le juge Mamadou Badio Camara. Les Sénégalais retiendront de lui celui qui a eu les coudées assez franches pour dire non à l’autorité politique. La tenue de la Présidentielle a été salvatrice pour notre démocratie. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye, contrairement à son Premier ministre qui a récemment traité cet éminent magistrat de «corrompu», a rendu hommage à un «grand serviteur de l’État.» Je m’incline devant la mémoire de ce grand Sénégalais.













